
Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon
Ligne directe : 07.80.99.23.28
contact@sisyphe-avocats.fr

La vacance de la Présidence de la République n’a pas de conséquence directe immédiate sur les mandats des députés ou sur les autres institutions. Si la logique commande une dissolution concomitante de l’Assemblée Nationale pour conférer une nouvelle majorité au Président, les textes ne l’obligent pas, interdisant même explicitement la dissolution opérée par le Président par intérim.
Historiquement, la situation de vacance de la Présidence de la République s’est présentée deux fois sous la Vème République, suite à la démission du Général de Gaulle le 28 avril 1969 et suite au décès du Président Georges Pompidou le 2 avril 1974. C’est le Président du Sénat Alain Poher qui, par deux fois, a alors assuré la Présidence de la République par intérim.
Dans la pire des situations, à savoir celle d’une forme grave de Covid-19 pour le Président Macron, ou pire, c’est le Président du Sénat Gérard Larcher qui assurerait donc l’intérim de la Présidence de la République pendant au moins 20 jours, jusqu’à convocation des électeurs aux urnes.
Une forme légère de Covid-19 n’implique enfin aucune vacance de la Présidence de la République, qui peut continuer à assurer ses fonctions pendant sa convalescence. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Ce faisant, le Premier ministre peut légalement porter atteinte, de manière mesurée, aux libertés fondamentales au nom de l’impératif de protection de la santé publique, composante sanitaire de l’ordre public.
Dans ce cadre, compte tenu de la persistance du nouveau coronavirus (covid-19) particulièrement contagieux sur le territoire national, le Premier ministre a pris un décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant un précédent décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 venant encadrer de manière particulièrement stricte la réouverture des établissements de culte (ERP de catégorie V) :
« Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies religieuses dans la limite de 30 personnes. ».
Considérant que ce décret portait atteinte à la liberté de culte en posant une limite de 30 personnes seulement pour les cérémonies religieuses, des associations religieuses catholiques ont saisi le Conseil d’État en urgence, lui demandant d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au Premier ministre de modifier cette limite pour tous les cultes.
La procédure de référé-liberté permet en effet au juge des référés de se prononcer très rapidement sous 48H et d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » à condition qu’il lui soit démontré (article L521-2 du code de justice administrative) :
Par une ordonnance du 29 novembre 2020, le Conseil d’État a donné raison aux requérants en enjoignant au Premier ministre de modifier, dans un délai maximum de 3 jours le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, afin d’encadrer de manière proportionnée les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et non pas de fixer une limite fixe de 30 personnes pour tous les lieux de culte.
C’est une décision bienvenue.
Pour parvenir à une telle solution, la Haute juridiction a pris en compte et rappelé de nombreux éléments.
En premier lieu, le Conseil d’État a considéré que la condition d’urgence était remplie compte tenu :
De manière surprenante, et à l’instar d’un précédent contentieux similaire en date du 18 mai 2020, les pouvoirs publics n’avaient même pas contesté cette situation d’urgence dans le cadre de leur défense.
En deuxième lieu, le Conseil d’État a confirmé une nouvelle fois, comme le 18 mai 2020, que la liberté du culte présentait le caractère d’une liberté fondamentale pouvant justifier un référé-liberté, ce qui n’est pas nouveau dans sa jurisprudence (CE, ord., 16 février 2004, Benaissa, n°264314).
La Haute juridiction a rappelé à nouveau que cette liberté ne se limitait pas au droit de tout individu d’exprimer individuellement les convictions religieuses de son choix, mais qu’elle comportait également, parmi ses « composantes essentielles », le droit de « participer collectivement (…) à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ».
Par le passé, le Conseil d’État avait d’ailleurs déjà pu juger que la « possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses » constituait une liberté fondamentale (CE, ord., 7 avril 2004, Kilicikesen, n°266085).
En troisième lieu, confrontant les principes à la situation d’espèce, le Conseil d’État a considéré que le Premier ministre avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte par son décret du 27 novembre 2020.
Le Conseil d’État n’a pas nié la nécessité pour le Premier ministre d’encadrer les rassemblements au sein des établissements de culte compte tenu de la persistance de l’épidémie, mais lui reproche d’avoir posé une jauge de 30 personnes disproportionnée et non-justifiée dans le nouveau contexte issu de l’allègement du confinement.
Dans un État de droit, la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception (CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855). Les pouvoirs publics doivent donc toujours concilier l’exercice des libertés fondamentales avec l’impératif de protection de l’ordre public en trouvant un point d’équilibre. Pour qu’une mesure de police soit légale, il faut ainsi qu’elle tende à maintenir l’ordre public par les moyens les moins rigoureux possible (CE, 21 janvier 1994, Commune de Dammarie-Les-Lys, n° 120043) et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux libertés fondamentales (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413).
Le Conseil d’État a jugé que l’intervention du Premier Ministre était nécessaire pour encadrer la fréquentation des établissements de culte dans la mesure où :
Mais dans le même temps le Conseil d’État a jugé que le décret du Premier Ministre était excessif dans la mesure où :
Il en résulte, selon le Conseil d’État, que la limite de 30 personnes maximum pour les cérémonies religieuses imposée par le décret contesté présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique. Cette interdiction constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante en cause de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.
Dans ces conditions, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai particulièrement bref de 3 jours maximum le décret initial n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, afin d’encadrer de manière proportionnée les rassemblements et réunions dans les établissements de culte, et non pas de fixer une limite fixe de 30 personnes pour tous les lieux de culte.
***
C’est un signal fort envoyé par le Conseil d’État aux pouvoirs publics par cette décision.
En rappelant à nouveau le principe de la proportionnalité de la mesure de police, même en période exceptionnelle d’épidémie, le Conseil d’État remet une nouvelle fois l’Église au milieu du village.
En rappelant une nouvelle fois que la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer individuellement les convictions religieuses de son choix, mais qu’elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement à des cérémonies, le Conseil d’État fait également œuvre utile.
Enfin, on se gardera d’analyser la décision commentée comme un blanc-seing donné par le Conseil d’État à tous les rassemblements dans les établissements de culte, dans n’importe quelles conditions. Un strict protocole sanitaire avec une jauge de participants exprimée en pourcentage de la superficie des locaux et non plus en valeur absolue permettrait aux pouvoirs publics de contenir l’épidémie dans le respect de l’exercice de la liberté de culte. Ils ont 3 jours maximum pour ce faire.
Décision commentée : CE, ord., 29 novembre 2020, Association Civitas et autres, n°446930 et suivants

Parce qu’il faut lutter par tous les moyens contre la propagation du virus, y compris du fait de l’accumulation des clients dans les grandes surfaces, j’ai pris cet après-midi un arrêté pour autoriser la réouverture de l’ensemble des #commerces de la ville de Chalon. #confinement pic.twitter.com/lSstwDTpuN
— Gilles PLATRET (@gillesplatret) October 30, 2020
J'ai pris un arrêté municipal autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires à #Béziers. Tous les commerces de la ville sont autorisés à reprendre leur activité dès ce samedi 31 octobre pic.twitter.com/U0GMtS3sYP
— Robert Ménard (@RobertMenardFR) October 30, 2020
« Les articles L. 2212 1 et L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales (…) autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’État, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État » (CE, 17 avril 2020, n° 440057).


Le Conseil constitutionnel a donc particulièrement insisté sur l’absence du juge dans les mécanismes de contrôle prévus par la loi « Avia », à laquelle il reproche donc la privatisation du contrôle de la liberté d’expression. Pour le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire doit donc conserver le monopole du contrôle de cette liberté, qui ne peut pas être délégué à des opérateurs privés comme les gestionnaires de réseaux sociaux.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel constate le caractère impraticable de la loi « Avia », avec des délais trop courts et des sanctions déraisonnables dès le premier manquement. Ces mécanismes excessifs ne peuvent en effet que conduire à un excès de prudence des opérateurs de plateforme en ligne à retirer tous les contenus qui leur seraient signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites selon le juge constitutionnel : la loi « Avia » portait en son sein un risque d’atteintes généralisées à la liberté d’expression.
Cette décision doit nous amener à réfléchir sur la place du juge constitutionnel dans le processus législatif, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Combien d’heures et de jours perdus par le législateur pour une loi finalement balayée par le juge constitutionnel ? La loi « Avia » devra nous servir collectivement de contre-exemple. Une réflexion sur la saisine pour avis du Conseil constitutionnel en amont du travail parlementaire sur les lois ordinaires pourrait être très utile.

Si le Président Emmanuel Macron venait à démissionner au cours de son second mandat, par exemple après les élections législatives anticipées ou en cas de majorité introuvable à l’Assemblée nationale et de crise politique, c’est le Conseil constitutionnel qui constaterait la vacance de la Présidence de la République.
Le second mandat du Président Macron s’achèverait donc instantanément de manière anticipée et les fonctions de Président de la République seraient temporairement exercées par le Président du Sénat Gérard Larcher.
Le scrutin pour l’élection du nouveau Président aurait alors lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l’ouverture de la vacance.
D’autres conséquences peuvent être relevées :
Historiquement, la démission d’un Président de la République ne s’est présentée une seule fois avec la célèbre démission du Général de Gaulle le 28 avril 1969 à la suite du référendum perdu sur la régionalisation et l’élection subséquente de Georges Pompidou. Le Président du Sénat Alain Poher avait alors assumé les fonctions de Président de la République par intérim pendant 1 mois et 23 jours :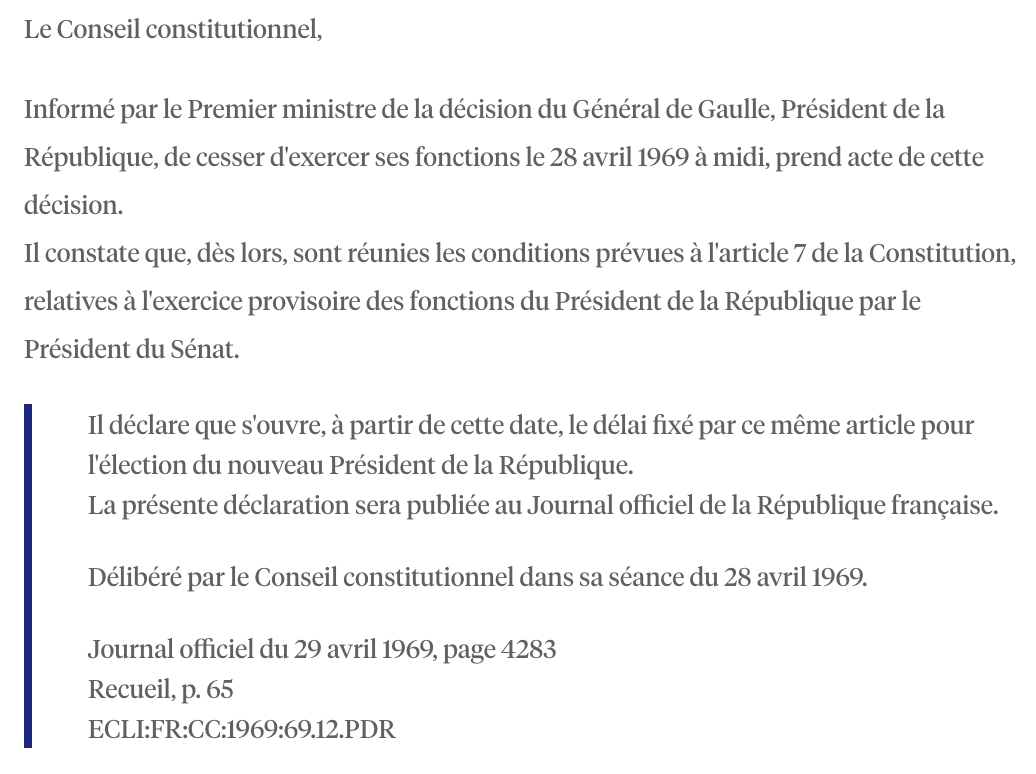

La requête des enseignants-chercheurs était appuyée par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui concluait aux mêmes fins que les requérants.
Ils faisaient notamment valoir que la neutralisation des notes inférieures à 10/20 était contraire :
En défense, un certain nombre de collectifs étudiants (AGE-UNEF, CJES, Solidaires Etudiants Paris 1) et de syndicats (CGT) concluaient au rejet de la requête.
Ils estimaient que la neutralisation des notes inférieures à 10/20 était parfaitement légale compte tenu du contexte particulier de l’épidémie de covid-19, faisant notamment valoir que l’inégalité numérique entre les étudiants rendait impossible l’égalité de traitement entre les candidats.
Par une ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours des enseignants-chercheurs de l’université Paris 1, en considérant que le doute sérieux quant à la légalité des délibérations de la CFVU n’était pas établi en l’espèce.
Pour parvenir à cette décision, le juge administratif a considéré que les circonstances liées à la pandémie de covid-19 ne permettaient pas l’organisation d’examens en présentiel mais, et c’est plus surprenant, pas non plus à distance.
Cette appréciation portée par le juge administratif repose principalement sur une enquête interne menée à l’université Paris I qui démontrerait que de nombreux étudiants n’auraient pas encore accès aux moyens leur permettant de bénéficier de l’enseignement à distance : « seuls 73 % des étudiants disposent d’un équipement informatique personnel et 40 % ne s’estiment pas en mesure de subir des épreuves à distance en un temps réduit ».
Par ailleurs, le juge a balayé d’une phrase les autres moyens soulevés par les requérants : « les moyens tirés (…) de la méconnaissance du principe d’indépendance des jurys et leur souveraineté, ainsi que de la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle d’indépendance des enseignants-chercheurs ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations contestées ».
Cette solution n’avait pourtant rien d’évident.
Il faut en effet rappeler, et c’est très important, qu’en matière de référé, le doute sérieux sur la légalité d’une décision administrative suffit au juge pour ordonner la suspension de la mesure, et non pas la preuve définitive de l’illégalité.
A minima, le Tribunal administratif de Paris aurait pu considérer qu’un doute sérieux était caractérisé en l’espèce quant à la légalité des délibérations contestées de la CFVU.
La neutralisation des notes inférieures à 10/20 pose en effet une vraie question juridique, qu’il appartiendra au juge administratif de trancher au fond, et si la question n’a pas encore été réglée en jurisprudence, les moyens avancés par les enseignants-chercheurs apparaissent comme sérieux.
Le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, selon lequel les modalités de contrôle des aptitudes et d'acquisition des connaissances ne peuvent pas être modifiées en cours d’année universitaire était facile à écarter, l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 ayant précisément pour objet de déroger à cette disposition compte tenu de l’épidémie de covid-19.
Mais en revanche, est solidement ancré en jurisprudence le principe de souveraineté des jurys d’examen : les jurys délibèrent souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats, ce qui implique, en amont de la délibération, un pouvoir souverain de notation de la part de l'enseignant. L’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites des candidats ne peut ainsi pas être utilement discutée au contentieux (CE, 17 juillet 2009, n°311972 ; CE, 8 octobre 2008, n°309017). Il est indéniable que la neutralisation des notes inférieures à 10/20 à l’université interfère avec ce principe de souveraineté du jury d’examen.
Par ailleurs, la motivation de la décision rendue par le Tribunal administratif en référé apparaît juridiquement faible, car reposant sur une seule enquête interne à l’université dépourvue par nature de toute valeur juridique. Précisément, le résultat d’un sondage selon lequel certains étudiants « ne s’estiment pas » en mesure de subir des épreuves à distance ne permet pas de fonder juridiquement une délibération de neutralisation de toutes les notes inférieures à 10/20 : il n’appartient pas aux étudiants de décider eux-mêmes des modalités de contrôle des aptitudes et d'acquisition des connaissances à l’université, encore moins via un sondage.
Les conclusions de la seule enquête interne sur laquelle s’est appuyé le juge administratif pour rendre sa décision surprenante sont par ailleurs très contestables, dans la mesure où de très nombreuses universités françaises ont pu valablement organiser des examens à distance pendant l’épidémie de covid-19 et que chaque enseignant a pu constater la grande facilité avec laquelle les étudiants ont pu suivre les cours et préparer leurs exercices à distance : les nouveaux outils numériques d’enseignement sont indénombrables, d’une facilité d’utilisation déconcertante et un simple smartphone suffit.
D'autant plus que l'ordonnance "covid-19" prévoit précisément la possibilité d'organiser des examens dématérialisés à distance, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats : "S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée" (article 2 de l'ordonnance).
La neutralisation des notes inférieures à la moyenne est enfin peu compréhensible :
Elle introduit en outre une discrimination difficilement acceptable entre les étudiants en fonction des résultats obtenus, au détriment des étudiants ayant obtenu une note supérieure à 10/20. Cette inégalité de traitement entre les étudiants est susceptible d’entacher d’illégalité les délibérations qui étaient contestées.
Le doute sérieux sur la légalité de la neutralisation des notes inférieures à 10/20 à l’université Paris-1 paraissait donc a minima établi, et le Tribunal administratif de Paris aurait donc pu par prudence suspendre l’exécution des délibérations contestées.
L’affaire va en tout état de cause prochainement rebondir et revenir devant le juge administratif.
Par un arrêté du 25 mai 2020, le recteur de la région académique d’Île-de-France a en effet suspendu l’exécution des délibérations contestées, et annoncé saisir lui-même le Tribunal administratif au visa de l'article L. 719-7 du code de l 'éducation (procédure rare de déféré rectoral). Cet article lui permet en effet de saisir le juge d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités des universités qui lui paraissent entachées d'illégalité, le tribunal devant alors statuer « d'urgence ».
En parallèle, le recours en cassation dirigé contre l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2020 est possible dans les 15 jours devant le Conseil d'État, qui doit alors statuer « dans les meilleurs délais ».
Espérons que le juge administratif pourra trancher cette question sur des bases juridiques plus solides que la décision surprenante rendue en référé par le Tribunal administratif de Paris, dans l’intérêt de tous les étudiants, qui ont tous et tout à perdre à la dévalorisation de leur diplôme.

L'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 liée à l'épidémie de covid-19 va plus loin en ajoutant que le conseil municipal peut même décider de se réunir dans un lieu situé hors du territoire de la commune compte tenu du contexte sanitaire, mais tout en rappelant que ce lieu ne doit pas contrevenir pas au principe de neutralité.
De la même manière, conformément à la loi du 25 janvier 1907 portant sur l’exercice public du culte et à la loi du 9 décembre 1905, les églises sont mises à la disposition du clergé et des fidèles et sont affectées exclusivement au culte. Tout autre usage est hors de la légalité, ce principe étant d’ordre public ce que le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises (CE, 1er mars 1912, Commune de Saint-Dézéry ; CE 25 août 2005 Commune de Massat, n° 284307).
La réunion d’un conseil municipal dans une église, même justifiée par un contexte extraordinaire d’épidémie contrevient donc directement aux dispositions légales applicables en matière de neutralité des édifices publics, qui a pour corollaire le principe de laïcité.
Ce que n’a pas manqué de relever le Préfet du Calvados, qui a déjà fait connaître son intention de faire annuler la première délibération issue de ce conseil municipal illégal : un déféré préfectoral sera probablement exercé afin de saisir le tribunal administratif de Caen.
Cette affaire rappelle d’autres actualités récentes que nous avions relevées, comme le maire de Morbecque qui avait apposé illégalement un gilet jaune géant sur la façade de sa commune, ou encore le président de l’Assemblée nationale qui avait de la même manière illégalement apposé un drapeau homosexuel sur la façade de l’Assemblée nationale à l’occasion de la fête dite « des fiertés ».
Le principe de neutralité applicable aux édifices publics vise précisément à éviter un tel mélange des genres et une instrumentalisation des biens communs au profit de revendications militantes.

- Le nouveau délai de recours contre les élections municipales 2020 est porté au vendredi 3 juillet 2020 au plus tard - Le recours doit être porté devant le Tribunal administratif de ressort - L'argument de l'abstention lié au contexte de covid-19 ne sera pas seul suffisant pour annuler l'élection, mais pourra être utilisé - Tous les électeurs, élus, éligibles, candidats peuvent agir Vous souhaitez contester les résultats des élections municipales 2020 dans votre commune ? Utilisez notre formulaire spécial. |

Ce faisant, le Premier ministre peut légalement porter atteinte, de manière mesurée, aux libertés fondamentales au nom de l’impératif de protection de la santé publique, composante sanitaire de l’ordre public.
Dans ce cadre, compte tenu de l’émergence du nouveau coronavirus (covid-19) particulièrement contagieux, le Premier ministre a pris un décret n°2020-548 du 11 mai 2020 venant encadrer de manière particulièrement stricte les établissements de culte (ERP de catégorie V) :
« Les établissements de culte, relevant du type V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit. / Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes, y compris dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent. ».
Le décret du 11 mai 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 interdisait donc de manière absolue tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Considérant que ce décret portait atteinte à la liberté de culte, des associations religieuses catholiques comme Civitas et un certain nombre de croyants ont saisi le Conseil d’État en urgence, lui demandant d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au Premier ministre de lever cette interdiction pour tous les cultes.
La procédure de référé-liberté permet en effet au juge des référés de se prononcer très rapidement sous 48H et d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale » à condition qu’il lui soit démontré (article L521-2 du code de justice administrative) :
Par une ordonnance du 18 mai 2020, le Conseil d’État a donné raison aux requérants en enjoignant au Premier ministre de modifier, dans un délai maximum de 8 jours le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, pour encadrer, et non pas interdire, les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.
C’est une décision bienvenue.
Pour parvenir à une telle solution, la Haute juridiction a pris en compte et rappelé de nombreux éléments.
En premier lieu, le Conseil d’État a considéré que la condition d’urgence était remplie compte tenu :
De manière surprenante, les pouvoirs publics n’avaient même pas contesté cette situation d’urgence dans le cadre de leur défense.
En deuxième lieu, le Conseil d’État a rappelé que la liberté du culte présentait le caractère d’une liberté fondamentale pouvant justifier un référé-liberté, ce qui n’est pas nouveau dans sa jurisprudence (CE, ord., 16 février 2004, Benaissa, n°264314).
Mais plus encore, et c’est le plus important, la Haute juridiction a précisé que cette liberté ne se limitait pas au droit de tout individu d’exprimer individuellement les convictions religieuses de son choix, mais qu’elle comportait également, parmi ses « composantes essentielles », le droit de « participer collectivement (…) à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ».
Par le passé, le Conseil d’État avait d’ailleurs déjà pu juger que la « possibilité d'exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses » constituait une liberté fondamentale (CE, ord., 7 avril 2004, Kilicikesen, n°266085).
En troisième lieu, confrontant les principes à la situation d’espèce, le Conseil d’État a considéré que le Premier ministre avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte par son décret du 11 mai 2020.
Le Conseil d’État n’a pas nié la nécessité pour le Premier ministre d’encadrer les établissements de culte compte tenu de l’épidémie, mais lui reproche d’avoir posé une interdiction trop générale et trop absolue dans le nouveau contexte issu du déconfinement.
Dans un État de droit, la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception (CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855). Les pouvoirs publics doivent donc toujours concilier l’exercice des libertés fondamentales avec l’impératif de protection de l’ordre public en trouvant un point d’équilibre. Pour qu’une mesure de police soit légale, il faut ainsi qu’elle tende à maintenir l’ordre public par les moyens les moins rigoureux possible (CE, 21 janvier 1994, Commune de Dammarie-Les-Lys, n° 120043) et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux libertés fondamentales (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413).
Le Conseil d’État a jugé que l’intervention du Premier Ministre était nécessaire pour encadrer les établissements de culte dans la mesure où :
Mais dans le même temps le Conseil d’État a jugé que le décret du Premier Ministre était excessif dans la mesure où :
Il en résulte, selon le Conseil d’État, que l’interdiction générale et absolue imposée par le décret contesté de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique. Cette interdiction constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.
Dans ces conditions, le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai maximum de 8 jours le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, pour encadrer, et non pas interdire, les rassemblements et réunions dans les établissements de culte.
C’est un signal fort envoyé par le Conseil d’État aux pouvoirs publics par cette décision.
En rappelant le principe de la proportionnalité de la mesure de police, même en période exceptionnelle d’épidémie, le Conseil d’État remet l’Église au milieu du village.
D’autant plus qu’en défense, le ministre de l’Intérieur avait fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ne pouvait être caractérisée puisque les établissements de culte étaient autorisés par le décret contesté à rester ouverts : seuls les rassemblements et réunions en leur sein étant interdit.
En rappelant que la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer individuellement les convictions religieuses de son choix, mais qu’elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement à des cérémonies, le Conseil d’État fait également œuvre utile.
On peut toutefois regretter l’analogie faite par la Haute juridiction entre la situation des établissements de culte et celle des magasins et centres commerciaux : les français ne se rendent pas à la messe comme au supermarché, et si elle est dénuée d’impact économique, la vie spirituelle n’en est pas moins essentielle pour la Nation.
Enfin, on se gardera d’analyser la décision commentée comme un blanc-seing donné par le Conseil d’État à tous les rassemblements dans les établissements de culte. Le rassemblement évangélique irresponsable de Mulhouse relevé dans la décision doit servir de leçon et de contre-exemple.
Il appartient désormais aux pouvoirs publics de trouver le juste curseur pour encadrer sous huitaine les rassemblements et réunions dans les établissements de culte afin de contenir l’épidémie, dans le respect de l’exercice de la liberté de culte.
Décision commentée : CE, ord., 18 mai 2020, M. W... et autres, n°440366 et suivants
INTERVENtions PRESSE