Faisant suite aux violents incidents qui ont émaillé Paris ce samedi 28 novembre 2020 au cours de la manifestation contre la loi de sécurité globale, d’aucuns se sont interrogés sur la réponse de l’État face aux « black blocs », ce groupe d’extrême gauche responsable des affrontements. Si le droit ne peut pas tout et qu’il est difficile de se prémunir de tout risque, trois pistes méritent toutefois d’être sérieusement envisagées.
1/ Peut-on juridiquement interdire les blacks blocs ?
- S’ils provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
- S’ils présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
- Ou s’ils ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.
La dissolution de l’association ou du groupement de fait prend la forme d’un simple décret en conseil des ministres.
Si les évènements du samedi 28 novembre se limitent à la destruction du mobilier urbain et de biens privés, ainsi que des faits de violence contre des représentants des forces de l'ordre, le gouvernement semble toutefois légitimement fondé, en théorie, à prononcer la dissolution des « black blocs » compte tenu de la situation insurrectionnelle rencontrée.
Néanmoins, un décret ministériel pris en ce sens n’aurait aucune incidence sur le réel. En effet, la mouvance « black blocs » est un groupement de fait, sans organisation, sans représentant, transnational et bien évidemment sans la moindre existence juridique. On touche alors aux limites de la puissance du droit : fût-il pris en conseil des ministres, un décret n’a pas la capacité de détruire un regroupement d’individus qui n’existe que ponctuellement, pour disparaître et se reconstituer aussitôt.
Juridiquement, les « black blocs » semblent donc insaisissables en tant que groupement, puisque le droit ne peut pas agir sur ce qui n’existe pas dans l’ordonnancement juridique.
2 / Peut-on sanctionner individuellement les blacks blocs ?
Sur le plan pénal, l’arsenal juridique semble suffisant pour sanctionner individuellement les « black blocs ».
En effet, comme nous l’avons d’ailleurs constaté ce 28 novembre, les individus identifiés comme casseurs au sein de la manifestation peuvent être rapidement interpellés par les forces de l’ordre, placés en garde à vue puis déférés rapidement devant le Procureur de la République ou le juge d’instruction.
Dans ce cadre, outre les sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la prison (en fonction des infractions commises) une interdiction de manifester pourra être prononcée à leur endroit sous la forme d’une peine complémentaire prévue à l’
article L. 211-13 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que :
« Les personnes s’étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique [de certaines infractions] encourent également la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. […] Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Cette interdiction pénale de manifester est toutefois prononcée a posteriori, alors que le mal est déjà fait dans cette hypothèse. Elle limitera le risque de récidive, mais n’aura aucun effet, par nature, sur les dégâts déjà occasionnés.
On touche alors à une limite de notre droit, mais également à une évolution possible : c’est la création d’une interdiction administrative individuelle de manifester, en amont de toute infraction, qui constitue une troisième piste.
3/ La création d’une interdiction administrative individuelle de manifester
Néanmoins, on constate que les « black blocs » se greffent toujours sur des manifestations existantes, en cours de défilé sans jamais en être à l’origine. L’interdiction préalable d’une manifestation dans son ensemble est donc sans effet sur ces groupes de casseurs.
Plus efficace semble être l’interdiction administrative individuelle de manifester, qui n’existe pas à ce jour dans notre droit : c’est l’idée de donner la possibilité aux Préfets d’interdire à un ou plusieurs individus identifiés de manifester, pour une durée déterminée, sans qu’ils n’aient jamais été nécessairement condamnés sur le plan pénal.
On pense ici à des individus identifiés par les pouvoirs publics comme appartenant à la mouvance « black blocs » qui n’auraient jamais été sanctionnés pénalement et s’apprêteraient à participer à une manifestation pour semer le chaos.
C’est dans le cadre d’un
rapport parlementaire de 2015 qu’avait été proposée au législateur l’introduction dans le droit français d’un tel dispositif préalable d’interdiction administrative de manifester, en l’absence de toute infraction pénale.
L’autorité préfectorale devrait alors apprécier si la personne concernée constitue une menace pour l’ordre public, en utilisant le faisceau d’indices suivant :
- L’individu a déjà été nominativement condamné (le cas échéant), ou est « connu en tant que casseur violent » (sans nécessairement avoir été condamné) ;
- Des risques sérieux et manifestes de trouble à l’ordre public sont existants ;
- Des indices matériels faisant redouter la commission d’une infraction à l’occasion de la manifestation ont été relevés.
L’arrêté emporterait alors interdiction préalable pour la personne identifiée, de pénétrer, pendant une durée déterminée, au sein d’un périmètre spécifique comme celui d’une manifestation.
On pourrait imaginer un système de pointage en commissariat ou gendarmerie à l’occasion de chaque grande manifestation, à l’instar de la procédure prévue pour les hooligans interdits de stade, obligés de pointer le jour de chaque rencontre sportive de leur équipe, afin de s’assurer de la neutralisation des individus identifiés comme
« black blocs ».
Mais, alors que cette nouvelle mesure proportionnée et très efficace avait été votée en première lecture par le Parlement dans le cadre de la très médiatique loi "anti-casseurs", c'est le Conseil constitutionnel qui a empêché son entrée en vigueur par sa décision contestable du 4 avril 2019 au nom du droit de toute personne à la "libre expression collective des idées et des opinions". L'interdiction administrative de manifester est pourtant par ailleurs déjà fréquemment utilisée en Belgique et en Allemagne, avec efficacité selon le rapport parlementaire susmentionné.
Il semble, au regard des violences du 28 novembre, que la piste de la création d’une interdiction administrative de manifester doive être aujourd'hui réactivée. Bien utilisée, elle aurait pour avantage de neutraliser des « black blocs » en amont de manifestations identifiées comme à risque et donc de limiter le risque de violence. N'en déplaise au Conseil constitutionnel, la liberté d'expression n'est pas la liberté de casser.
Cette mesure n’est pas seule à même de répondre à la menace
« black blocs » et le droit ne peut pas tout face au réel. Elle a toutefois le mérite de constituer une piste intéressante d’évolution de notre droit, aux fins de préserver partout l’ordre républicain.



 Dans la nuit du 29 décembre 2017, une jeune femme de 22 ans, Mme Naomi Musenga est tragiquement décédée suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Il résulte d’un enregistrement audio glaçant de l’échange entre Mme Musenga et le service d’urgence que ce dernier n’aurait pas pris au sérieux sa pathologie (défaillance multi viscérale sur choc hémorragique) allant même jusqu’en plaisanter :
Dans la nuit du 29 décembre 2017, une jeune femme de 22 ans, Mme Naomi Musenga est tragiquement décédée suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Il résulte d’un enregistrement audio glaçant de l’échange entre Mme Musenga et le service d’urgence que ce dernier n’aurait pas pris au sérieux sa pathologie (défaillance multi viscérale sur choc hémorragique) allant même jusqu’en plaisanter :

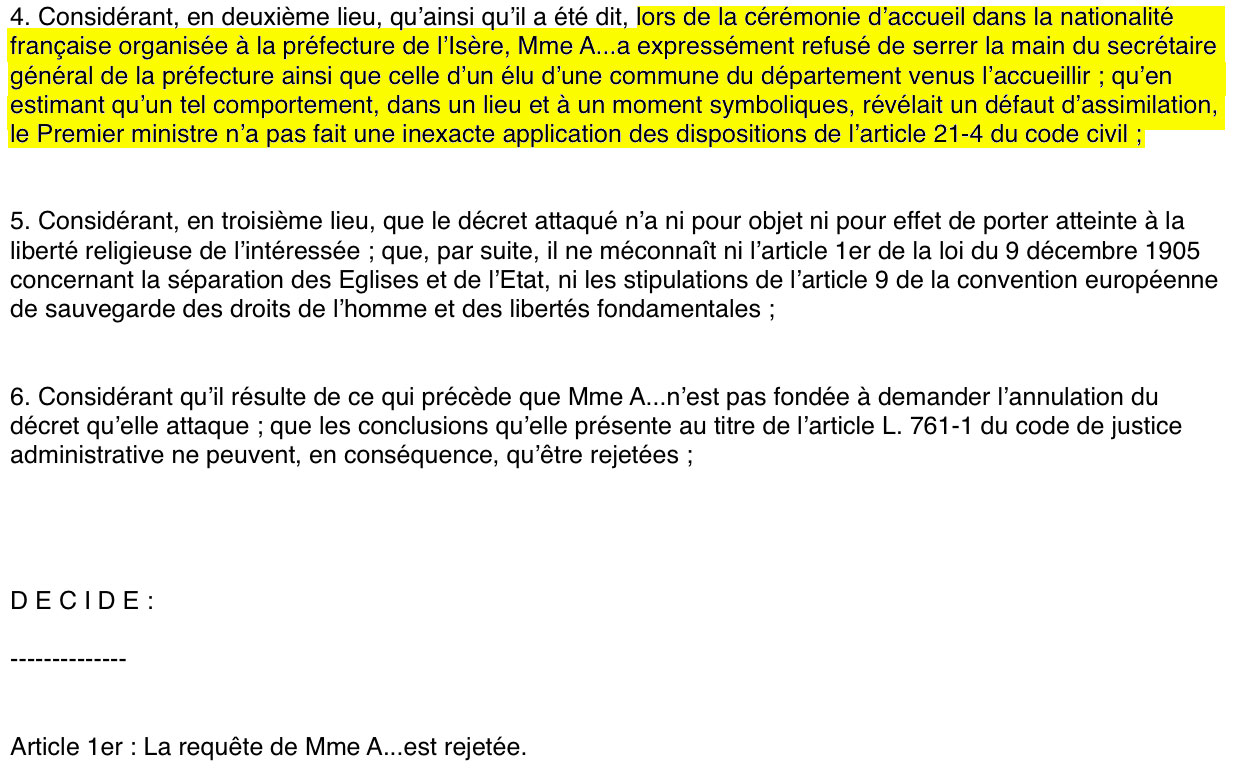
 « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit ! » disait le Président Sarkozy le 5 juillet 2008. Force est toutefois de constater que la grève qui touche actuellement la SNCF n’est pas passée inaperçue pour les français.
« Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit ! » disait le Président Sarkozy le 5 juillet 2008. Force est toutefois de constater que la grève qui touche actuellement la SNCF n’est pas passée inaperçue pour les français. 
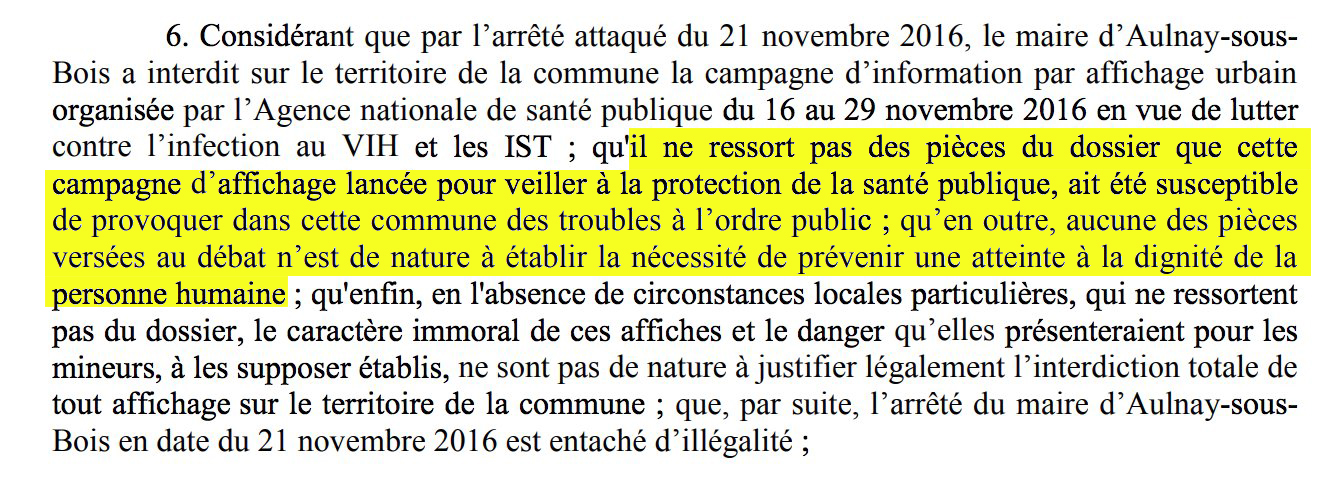
 Interrogé spécifiquement sur le cas des mères voilées accompagnant les sorties scolaires (Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI), le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré dimanche qu'un parent accompagnant une sortie scolaire devait être considéré comme un « collaborateur bénévole du service public » et ne devrait « normalement » pas porter de signe religieux (BFMTV).
Interrogé spécifiquement sur le cas des mères voilées accompagnant les sorties scolaires (Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI), le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré dimanche qu'un parent accompagnant une sortie scolaire devait être considéré comme un « collaborateur bénévole du service public » et ne devrait « normalement » pas porter de signe religieux (BFMTV).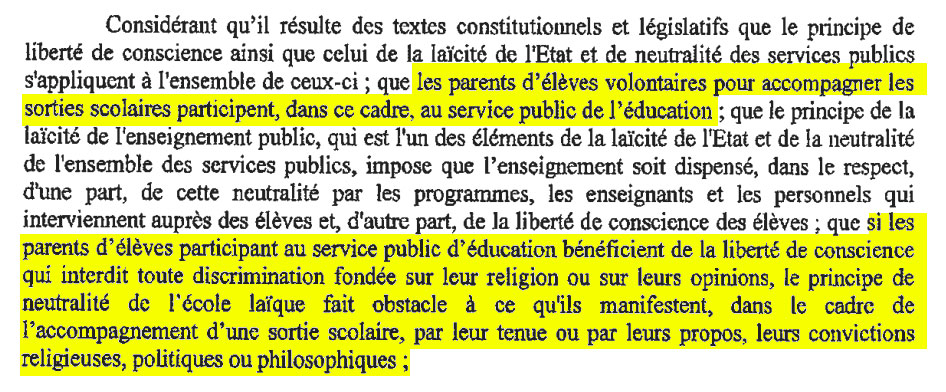
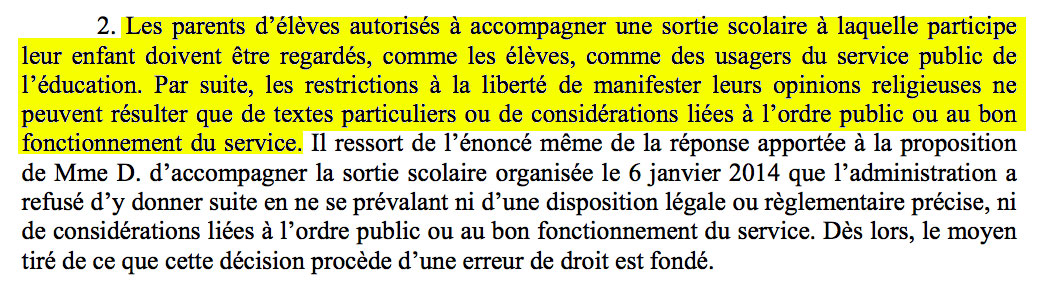
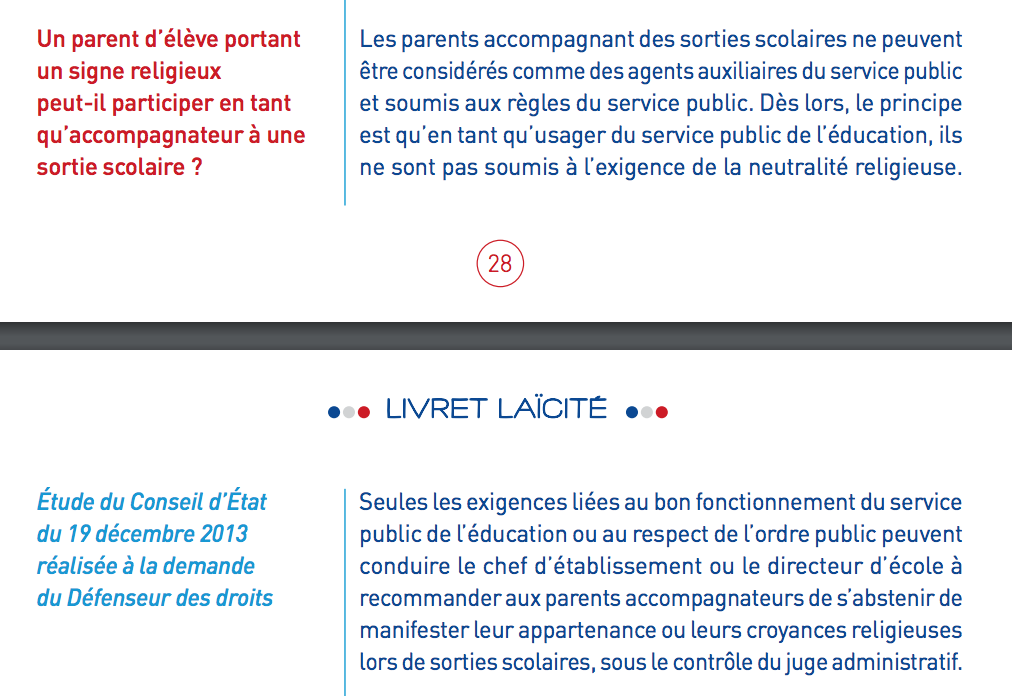
 Affiche de la manifestation interdite
Affiche de la manifestation interdite
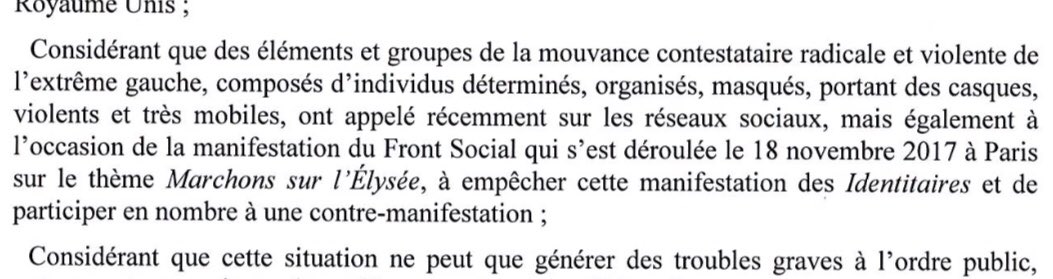

 Par une décision du 25 octobre 2017 « Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres », le Conseil d’Etat a jugé contraire à la loi du 9 décembre 1905 l’installation d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place de la commune de Ploërmel (Morbihan).
Par une décision du 25 octobre 2017 « Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres », le Conseil d’Etat a jugé contraire à la loi du 9 décembre 1905 l’installation d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place de la commune de Ploërmel (Morbihan).